Faire face au négationnisme du génocide des Tutsi est un antidote au poison de la négation.
C’est un outil indispensable à tous ceux qui veulent préserver la portée politique et le pouvoir d’interrogation de notre humanité que portent le travail de mémoire et d’histoire des génocides.
Pour parer à l’inflation des tentatives falsificatrices des nouveaux assassins de la mémoire, Josias Semujanga et Jean-Luc Galabert ont fait appel aux plus éminents experts du négationnisme du dernier génocide du XXe siècle.
Le génocide et sa négation sont structurellement liés. Avant d’être accompli, le projet génocidaire est dissimulé ; pendant son accomplissement, la réalité de l’extermination est démentie ; après avoir été perpétré, la nature même du génocide est déniée.
Après le génocide des Arméniens, des juifs et des Tziganes, celui des Tutsi du Rwanda confirme cette règle.
Pour parer à l’inflation des tentatives falsificatrices des nouveaux assassins de la mémoire, Josias Semujanga et Jean-Luc Galabert ont fait appel aux plus éminents experts du négationnisme du dernier génocide du XXe siècle.
Leurs contributions permettent d’en comprendre les différentes facettes : sa genèse, ses procédés, ses motivations, ses déclinaisons, ses médias, ses conséquences, ses acteurs et ses relais. Faire face au négationnisme du génocide des Tutsi est un antidote au poison de la négation.
C’est un outil indispensable à tous ceux qui veulent préserver la portée politique et le pouvoir d’interrogation de notre humanité que portent le travail de mémoire et d’histoire des génocides.
Avec les contributions de :
Philippe BASABOSE – Jean-Damascène BIZIMANA – Virginie BRINKER – Véronique CHELIN – Catherine COQUIO – Alexandre DAUGE-ROTH – Jean-Luc GALABERT – Eric GILLET – Jean-Paul GOUTEUX – José KAGABO – Faustin KAGAME – Jean-Marie KAYISHEMA – Jean MUKIMBIRI – Tom NDAHIRO – Jean NDORIMANA – Eugène NSHIMIYIMANA – Évariste NTAKIRUTIMANA – Michael RINN – Catalina SAGARRA – Josias SEMUJANGA – Yves TERNON
Référence
Table des matières
Josias Semujanga Introduction: Le négationnisme de l’Itsembabwoko, dénégation et manipulation politique
Partie I: Les logiques fondatrices du négationnisme
Eugène Nshimiyimana Profession de haine : du « syndrome du ‘Hutu’ » au négationnisme/révisionnisme du Génocide contre les Tutsi
Catalina Sagarra Le négationnisme : prémisses discursives d’un système de pensée
Évariste Ntakirutimana Le négationnisme du génocide rwandais en paroles et en actions
Jean Mukimbiri Génocide « rwandais ? » : Présupposés et visées d’une informelle requalification
Philippe Basabose Discours du déni : de la vérisimilitude à la vérisimulation
Jean-Marie Kayishema Du mythe hamite au génocide des Tutsi et à sa négation
Yves Ternon Approche comparée de la négation des génocides avérés du XXe siècle
Partie II: Le négationnisme du génocide en Europe
Catherine Coquio Le génocide des Tutsi du Rwanda vu de France : de la scène politique au voile esthétique
Jean-Paul Gouteux Mémoire et révisionnisme du génocide des Tutsi rwandais en France : Racines politiques, impact médiatique
Faustin Kagame Négationnisme, banalisation du génocide et atteinte à la mémoire des victimes, à l’occasion du premier procès pour crime de génocide en Suisse
Tom Ndahiro Pierre Péan : Du laxisme européen en matière de négationnisme à « l’ère du plus jamais ça »
Partie III: Les médias du négationnisme
Véronique Chelin Le négationnisme du bourreau dans la presse écrite et la littérature : le cas du génocide au Rwanda
Alexandre Dauge-Roth Le cinéma face au génocide contre les Tutsi du Rwanda ou le risque de faire écran en mettant à l’écran
Michael Rinn La sophistique négationniste sur internet, Passions du déni du génocide des Tutsi rwandais
Jean Ndorimana Église Catholique et négationnisme
Dr Jean Damascène Bizimana Le négationnisme dans les institutions judiciaires : les juridictions françaises, espagnoles et le Tribunal Pénal International pour le Rwanda
Justin Gahigi Métastases du discours négationniste et inflation conflictuelle au Kivu
Partie IV: Agir contre le négationnisme
Virginie Brinker Comment les écrivains s’opposent-ils au négationnisme ou la question de la transmission du génocide des Tutsi du Rwanda
Éric Gillet La répression du négationnisme en Belgique et en Europe
Jean Mukimbiri Pour une déconstruction du négationnisme du génocide anti-tutsi Arguments et contre-arguments
José Kagabo Du bon usage du terme négationnisme
Jean-Luc Galabert Conclusion: Non reconnaissance, négation, déni du génocide Faire la part des choses pour faire face au négationnisme
Présentation des auteurs
Bibliographie
Remerciements
Fiche technique
Sous la direction de J. Semujanga et J. Galabert
Editeur: Izuba
Collection: Essai
Date de parution: avril 2013
410 pages
Auteur(s)
Avec les contributions de :
Philippe BASABOSE – Jean-Damascène BIZIMANA – Virginie BRINKER – Véronique CHELIN – Catherine COQUIO – Alexandre DAUGE-ROTH – Jean-Luc GALABERT – Eric GILLET – Jean-Paul GOUTEUX – José KAGABO – Faustin KAGAME – Jean-Marie KAYISHEMA – Jean MUKIMBIRI – Tom NDAHIRO – Jean NDORIMANA – Eugène NSHIMIYIMANA – Évariste NTAKIRUTIMANA – Michael RINN – Catalina SAGARRA – Josias SEMUJANGA – Yves TERNON
Informations complémentaires
| Poids | 0,6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 2,6 × 16 × 24 cm |
| Pages | 410 |
| Format | Broché |
Couverture / Illustrations
Couverture :
Bruce Clarke
www.bruce-clarke.com
Acheter
Livraison à Kigali et/ou
e-books (formats numériques)
Fr 25 000
Livraison par coursier partout dans Kigali (sous réserve de disponibilité) ou téléchargement sur ce site
Commandes libraires et associations
Extraits
EXTRAIT DE L’INTRODUCTION (Josias Semujanga):
Le négationnisme de l’Itsembabwoko, dénégation et manipulation politique
« À l’heure des bilans, deux innovations prodigieuses devront être expressément portées au crédit du XXe siècle : le génocide et sa démystification, la capacité scientifique d’en finir avec l’existence de certains groupes humains, redoublée par l’aptitude à liquider leur mort. […] il y a une telle continuité entre ces projets, qu’il est à la fois légitime et inévitable d’en inférer la complicité. »
Alain Finkielkraut
Retour sur les mots
En exergue à l’ouverture du présent ouvrage Faire face au négationnisme du génocide des Tutsi, la voix d’Alain Finkielkraut fait écho à celles d’Yves Ternon et d’Éric Gilet. Elles appellent au combat contre le négationnisme en le situant dans le projet génocidaire, projet dont la base idéologique de déchoir les futures victimes de leurs statuts d’êtres humains se prolonge tout naturellement dans le déni du crime. De la Shoah à l’Itsembabwoko, il est possible, en effet, de retracer les rapports entre les idéologies racistes, au sens où Hannah Arendt définit ce terme, « comme la logique s’accomplissant totalement (et relevant d’une volonté de l’accomplissement total), d’une idée, qui permet d’expliquer le mouvement de l’histoire comme un processus unique et cohérent […] de telle sorte que tout ce qui arrive, arrive conformément à la logique d’une idée», et le génocide, comme massacre visant à protéger la pureté d’un peuple. Une propagande manipule les mots comme si, avant la destruction des corps, il fallait empêcher la langue de dire la vérité du crime par la création de nouvelles habitudes langagières.
Après le génocide, on retourne à la langue pour trouver un mot pour exorciser les horreurs. Au Rwanda, après le génocide, la nouvelle vie recommence sur les ruines de l’ancienne, mais les mots bégaient lorsque vient le temps de parler du génocide, comme l’analyse dans ce dossier Évariste Ntakirutimana, à partir des journaux de l’époque. De nombreux termes se font concurrence dont trois plus importants dans le discours officiel. Tout d’abord, dès 1995, le terme itsembabwoko qui signifie « l’éradication d’une race, d’une lignée ou d’un groupement humain », désigne le génocide des Batutsi, et itsembatsemba, dont le sens est au fond le même que itsembabwoko, désigne l’assassinat ciblé de nombreux chefs politiques Bahutu pour leurs idées libérales. Amalgamant les deux termes, le discours officiel retient itsembabwoko n’itsembatsemba jusqu’en 2002 qui voit entrer dans le texte de la Constitution le mot jenoside, c’est-à-dire le mot français épelé selon la logique de l’alphabet phonétique du kinyarwanda. En 2008, le gouvernement adopte le terme jenoside yakorewe Abatutsi (le génocide des Batutsi).
De tous ces termes, Jenoside et Itsembwabwoko sont les plus utilisés au Rwanda ; le premier revient le plus souvent dans les échanges verbaux ou écrits sur le sujet et il est plus attesté dans les différents offices de l’État chargés des rescapés du génocide, comme le FARG (Fonds d’aide pour les rescapés du génocide) ou la CNLG (Commission nationale pour la lutte contre le génocide) alors que le second a été popularisé par les médias en kinyarwanda. Une telle instabilité terminologique des mots pour désigner le génocide de la part de l’État témoigne justement de la pression des négationnistes. Elle est en décalage avec les termes utilisés par le public. Et le dernier, Jenoside yakorewe Abatutsi, s’il est le plus précis, est le moins retenu par le public car il ne répond pas aux normes de la brièveté qu’exige la communication sociale. Ainsi le vocable itsembwabwoko-n’itsembatsembwa est-il déjà tombé en désuétude, condamné sans doute par sa longueur et sa redondance.
Comme à l’époque de Lemkin, le Rwanda est à la recherche d’un mot précis pour circonscrire et exorciser le génocide. Une telle quête s’énonce comme un acte politique : utiliser le mot génocide, c’est condamner ses auteurs et l’idéologie de la haine qui l’a justifié. Utiliser le mot, c’est désigner le coupable, proférer un jugement sur le bourreau et faire vivre la mémoire de la victime. En l’absence de la dimension morale du mot, le génocide devient « massacre » ou tout simplement « autodéfense » ou « légitime défense », en espérant ainsi combler « les espaces vacants pour s’assurer, peut-être illusoirement, d’une sorte de plénitude du sens ».
En même temps, dans la prison de Rilima, au Bugesera, tels génocidaires dont Jean Hatzfeld a recueilli les témoignages, affirment que la destruction des Batutsi était une bonne action. Une telle parole est-elle négationniste si les prisonniers de Rilima, qui ont plaidé coupable pour les crimes de génocide refusent le mot pour les désigner ? Une interrogation à laquelle répond en quelque sorte l’article d’Éric Gilet parlant « des génocidaires comme des négationnistes originels ».
Dans le cas du Rwanda, Éric Gilet rappelle dans cet ouvrage l’irritation du Major Ntuyahaga provoquée par la question sur sa responsabilité dans le génocide. Il en est de même des prisonniers de Rilima ou d’autres négationnistes rwandais dont les nombreux écrits nient le génocide. À y regarder de près, ce n’est pas tant la négation des faits, car les prisonniers de Rilima ont plaidé coupable, mais ce qui est détesté, c’est le mot « génocide ». Car utiliser ce mot c’est poser un acte politique : condamner le génocide et le projet qui le sous-tend. Les prisonniers l’ont bien compris : ils acceptent le crime et tentent de sauver le projet de tuer les Batutsi plus tard !
Eugène Nshimiyimana et Évariste Ntakirutimana situent en effet, chacun à sa façon, la négation de l’Itsembabwoko dans la genèse et le développement du « syndrome hutu » dans l’espace politique rwandais depuis 1957 : sorte de pensée magique politique dans laquelle les Batutsi occupent une place marginale susceptible d’être effacée selon les circonstances politiques.
Aux origines du négationnisme
Comprendre le négationnisme de l’Itsembabwoko, c’est aussi le situer dans le contexte de la Shoah, comme métaphore absolue de tous les génocides. Parler du génocide aujourd’hui, c’est convoquer le registre linguistique créé par la nécessité de parler des crimes nazis. Au moment où l’Itsembawoko survient, l’Occident est en butte avec le négationnisme dans plusieurs pays et depuis une décennie au moins. La négation systématique des crimes nazis par des historiens se définissant comme révisionnistes, donnait, comme le dit Alain Finkielkrault, « le cauchemar, le dégoût et l’indignation d’entendre qu’un peuple bien vivant a accrédité le mensonge de son extermination pour en tirer des bénéfices.»
Ce discours aberrant et provocateur a déclenché des réactions en chaîne, et il a bien fallu trouver un mot pour désigner le nouveau révisionnisme afin de le différencier d’une démarche analytique, qui, en histoire, consistait à réviser de manière rationnelle certaines opinions admises en s’appuyant sur des informations nouvelles pour proposer une nouvelle interprétation des événements.
Car si « l’histoire ne s’énonce pas comme un ensemble de théorèmes ni même des lois [et que] la détermination ou l’interprétation des faits est infinie et infiniment révisable », la critique historique obéit à des lois qui valident le savoir, lois auxquelles les négationnistes ne se conforment pas et dont le non respect les disqualifie comme chercheurs. Le nouveau mot était également nécessaire puisque le terme révisionnisme désigne aussi dans le discours marxiste une position de déviation par rapport à une certaine orthodoxie idéologique.
Chaïman Perelman rappelle que les conflits s’énoncent avant tout comme des batailles pour la dénomination où toutes les recettes de l’argumentation sont convoquées aussi bien pour la séduction démagogique que pour la manipulation mensongère. Il a fallu donc inventer les mots pour contrer la manipulation des nouveaux révisionnistes voulant rendre flou le sens des mots pour mieux nier ou relativiser le génocide. Quarante ans auparavant, il avait été absolument nécessaire de créer le mot génocide pour dire la profondeur abyssale des crimes nazis pour les différencier des crimes de masse connus jusque-là.
En ce sens, le choix du mot négationnisme a l’avantage sur les autres, car il signale une systématisation d’une négation dans un discours allant au-delà de son usage habituel de la négation dans toutes les langues où elle procède de la fonction logique en cours dans les échanges verbaux.
Le négationnisme ne se fonde ni sur un doute légitime, ni sur une interprétation des textes permettant de réviser une vérité établie, mais sur une manipulation subtile, visant à faire partager au destinataire sa vision du monde hostile aux victimes du génocide…
(…)
On en parle
Rencontre : Négationnisme du génocide des Tutsi (Paris)
Lundi 1 avril 2019 – 14h30 au Mémorial de la Shoah | Paris
https://izuba.info/rencontre-negationnisme-du-genocide-des,1020.html
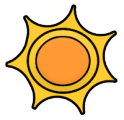
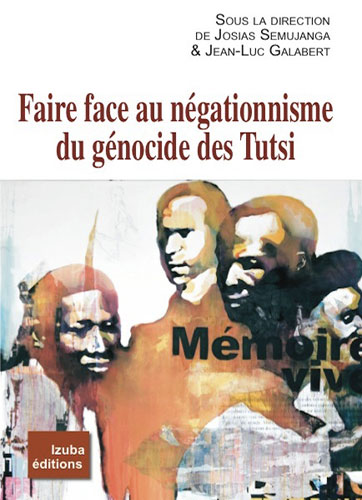

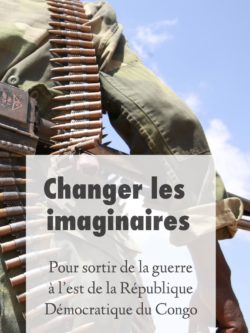
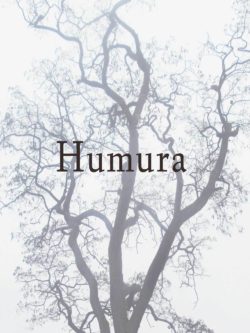


Commentaires